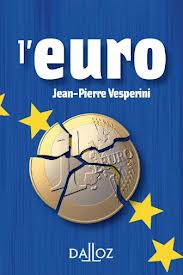Rassemblement Populaire Français (RPF Essonnes)
Adhérer au RPF (explication) RPF 3 rue du Point du Jour 54210 Saint-Nicolas-De-Port Courriel : rpf.contact@voila.fr Tél. : 03 83 46 83 59 Sinon mon courriel : talbotcy@gmail.com (Evry) pour information d’adhésion (envoi rapide par courrier)L’actif total des banques chypriotes est de 750% du PIB, soit deux fois plus que la moyenne de la zone euro ! les fameux CDS pourraient nous embarquer dans de sérieux ennuis
Si l’accord n’est pas ratifié par le parlement chypriote, la Banque Centrale Européenne cessera mardi de fournir des liquidités aux banques du pays, ce qui signifie la mort quasi-immédiate de nombreuses banques, un écroulement du système bancaire et un effet de contagion risquant d’entrainer la faillite du reste du pays. Le gouvernement étant totalement incapable de garantir les dépôts, les épargnants chypriotes perdront une grande partie de leur épargne avec les faillites bancaires.
Le second scénario, le scénario « douloureux mais contrôlé », implique donc la taxation des dépôts et la mise en place d’autres réformes (hausse de l’imposition sur les sociétés de 10 à 12,5% et privatisation dans le secteur public) et permettrait, je cite le président chypriote « un sauvetage historique et permanent du pays.
il faut savoir que le secteur bancaire à Chypre a une taille démesurée par rapport au reste de l’économie. Chypre est en effet un « petit » paradis fiscal, entre autre pour de très nombreux oligarques Russes, avec de plus de nombreux soupçons de blanchiment d’argent dans les banques chypriotes. Le plan d’aide est d’ailleurs aussi conditionné à la mise en place d’un audit sur le blanchiment d’argent, comme le rapporte l’Eurogroupe
Chypre est un tout petit pays, avec un PIB d’environ 18 milliards d’euros. La taxation des dépôts devrait rapporter environ 5,8 milliards d’euros, soit environ 32% du PIB. C’est tout simplement gigantesque ! C’est un peu comme si en France, on imposait une taxe rapportant 640 milliards d’euros (alors que pour rappel, on se bat actuellement pour savoir comment trouver environ 5 milliards d’euros).
Selon l’étude du BCG, il faudrait en France une taxe « unique et ponctuelle » de 19% sur l’ensemble des actifs financiers pour rétablir les dettes à un niveau soutenable. Oui oui, cela signifie bien que si vous avez 20.000 euros en actifs financiers et que du jour au lendemain, sur un scénario « à la chypriote », le gouvernement applique la recommandation du BCG, vous n’aurez plus que 16.200 euros d’actifs financiers.
Le problème des banques chypriote c’est qu’elle détenait énormément de dettes grecque mais quand je dit énormément c’est vraiment énormément. Ce qui fait que lors de la restructuration de la dette grecque
Tiens tiens voila les socialistes (voila du larcin) L’Amnestie sociale déguisée
Cela étant, je ne suis pas absolument certain, sur un plan purement juridique, que les circonstances exigées par la proposition de loi soient réunies à propos des affaires qui sont actuellement en cours d’instruction, même en prenant dans son sens le plus large l’expression « à l’occasion d’activités syndicales ». Tout dépendra du sens que le juge souhaitera donner à cette phrase sibylline. Car il n’est pas assuré qu’aux yeux de la justice, voler et piller des fonds publics relèvent de l’activité syndicale Explication hervé Beaudin source : *Forum Pour la France*
http://www.boursorama.com/forum-politique-amnistie-y-compris-les-detournements-423356496-1 ça me rappele la présomption d’innoncence camouflée vers la politique
C’est quoi exactement le RPF (explications)
== Principes gaullistes ==
– Préserver la souveraineté nationale ( en danger avec l’UE)
– L’indépendance et la non-dépendance vis à vis de l’extérieur
– Le respect et le maintien des institutions de la cinquième république
– L’Association capital travail,(scop,scic,coopérative,etc.)
– Progrés social et économique indexé
– Refus du capitalisme libéral et financier, régulation
La vision de la Grandeur, la transcendance, l’Etat doit diriger la marche économique de la France (le contraire aujourd’hui et déjà au temps de Mitterrand) et le peuple, c’est à dire la nation (communauté de destin)
Relation De Gaulle et Malraux
Sur Malraux, entretien avec Maurice Schumann
Maurice SCHUMANN (Entretien avec Philippe de SAINT ROBERT)
Sur Malraux, entretien avec Maurice Schumann par Philippe de Saint Robert, Espoir n°62, 1988
Nous savons bien que les rapports du général de Gaulle et d’André Malraux ont souvent fait tiquer les uns, ont parfois aussi déconcerté les autres : comment l’André Malraux de L’Espoir et de la guerre d’Espagne avait-il rejoint le général de Gaulle, le chef du RPF, le fondateur d’une République que certains voulaient encore croire à l’époque autoritaire ? Pour ma part et pour la vôtre, Maurice Schumann, je pense que le ralliement, si j’ose dire, ou plutôt la rencontre d’André Malraux avec le général de Gaulle n’avait rien de bien singulier.
Maurice Schumann – En fait, je ne parlerai pas de rencontre, je parlerai de coup de foudre. Geoffroy de Courcel, qui n’a rien d’un passionné ou rien d’un passionnel, en tout cas, a employé cette expression : il a été témoin de la rencontre. Ce coup de foudre a duré aussi longtemps que le général de Gaulle est resté au pouvoir, c’est-à-dire aussi longtemps que Malraux est resté ministre et, comme vous le savez, il a donné sa démission, il a abandonné le gouvernement le jour même où le général de Gaulle descendait du pouvoir dans des conditions que personne n’a oubliées. J’ai eu le privilège extraordinaire, j’ai du mal à y croire quand j’y pense, d’être ministre d’Etat du général de Gaulle en même temps qu’André Malraux naturellement était à sa droite.
Philippe de Saint Robert – Et vous étiez à gauche ?
M.S. – J’y étais parfois et j’ai été extrêmement frappé par la connivence profonde des deux hommes. Et, loin de me sembler paradoxal, ce coup de foudre m’apparaît comme d’une parfaite logique. Ce que de Gaulle doit à Malraux ne doit jamais être oublié. Vous savez qu’on cite toujours une phrase, on a raison de la citer d’ailleurs, qui est une phrase d’hommage : « Cet ami génial, fervent des hautes destinées », mais lisons-la jusqu’au bout : « L’idée que se fait de moi cet incomparable témoin contribue à m’affermir. Je sais que dans le débat, quand le sujet est grave, son fulgurant jugement m’aidera à dissiper les ombres ». J’ai été témoin, moi, de cela. Je me rappelle un débat sur un projet de dévaluation. Dieu sait que de Gaulle en connaissait plus en matière financière, bien qu’il ne fût pas spécialiste, que Malraux qui probablement n’y connaissait rien.
P.S.R. – Cela, c’est en 1968.
M.S. – Oui, c’est cela, très exactement à l’époque où nous étions ensemble ministres d’Etat. Le Général ne savait pas en entrant au conseil des ministres la conclusion qu’il tirerait du colloque. Chacun exprimait son opinion et nul ne l’a convaincu. Malraux l’a convaincu le moment venu avec des arguments qui se ramenaient à un seul : dans les circonstances présentes, de Gaulle ne peut pas faire cela, parce que, s’il le faisait, il donnerait de lui-même une image différente de la vraie, de celle qu’il doit donner et maintenir. L’influence ne s’arrête pas là, je veux dire le service ne s’arrête pas là, car il s’agit de service beaucoup plus que d’influence. Malraux a révélé l’Asie au général de Gaulle, il l’a dit un jour, il ne lui a pas seulement révélé Nehru, il ne lui a pas seulement révélé Mao-Ze dong, il lui a révélé, il lui a donné le sens de la curiosité de l’Asie. Lorsque j’ai été reçu en 1972 par Mao, il m’a dit d’emblée : « Pourquoi avez-vous laissé mourir le général de Gaulle ? C’est une des rares personnes que j’avais envie de rencontrer ». En fait, le général de Gaulle avait l’intention de se rendre en Chine au moment où la mort l’a saisi. Alors je parle à dessein de service rendu plutôt que d’influence, parce que, contrairement à une légende, je ne crois pas que Malraux ait eu à changer l’opinion du général de Gaulle sur l’Algérie, sur l’Indochine ; c’est par des voies différentes qu’ils ont abouti à la même conclusion. La sensibilité de Malraux, qui s’explique par sa jeunesse, est une sensibilité anticolonialiste. Le raisonnement du général de Gaulle est tout à fait différent.
P.S.R. – C’était rendre sa liberté à la France.
M.S. – Rendre sa liberté à la France est une excellente définition, et lui permettre de jouer un rôle mondial à la fin du XXe siècle en ne s’accrochant pas à ce qui avait été la manière du XIXe et du premier tiers du XXe.
P.S.R. – Maurice Schumann, même les grandes choses ne vont pas quelquefois sans malentendus. Ne croyez-vous pas qu’au départ, lorsque Malraux est devenu ministre du général de Gaulle, il avait peut-être davantage d’ambition que celle d’être seulement ministre de la Culture ?
M.S. – Je me m’en suis jamais rendu compte, c’est peut-être vrai, mais je ne m’en suis jamais rendu compte et en tout cas, le moins qu’on puisse dire, est qu’il n’a jamais tenu rigueur au général de Gaulle, si c’est ce que vous voulez dire…
P.S.R. – Non, certainement pas…
M.S. – … de n’avoir pas fait de lui son Premier ministre.
P.S.R. – Mais on a pensé qu’au moment de la guerre d’Algérie, Malraux avait peut-être imaginé jouer un rôle plus grand sur le plan strictement politique. Vous n’avez jamais eu ce sentiment ?
M.S. – En tout cas, il est incontestable que, lorsqu’il est parti pour l’Amérique par exemple, le général de Gaulle a tenu à préciser qu’il s’agissait d’un voyage culturel et pas d’un voyage politique. Inversement, j’ai été témoin de la manière dont Malraux, je ne dirai pas gérait son ministère, mais de la manière dont, autour de la table du conseil, il s’exprimait en ministre de la culture. Vous savez que son ambition était de faire pour la culture, chacun l’a dit, ce que la IIIe République avait fait pour l’enseignement : chaque enfant de France a droit aux tableaux, au théâtre, au cinéma comme à l’alphabet, etc. Quand il s’agissait de musées, d’initiatives en faveur des grandes expositions, de théâtre, de cinéma, voire de maisons de la Culture, il se passionnait et en même temps il était précis, précis dans ses exposés : c’était un ministre. Il n’a pas fait que changer la couleur de Paris.
P.S.R. – D’ailleurs dans le livre qui suit ce colloque, il y a évidemment des témoignages sur toutes sortes d’aspects des relations du général de Gaulle et d’André Malraux. Il y a des témoignages sur l’époque du RPF où Malraux, d’ailleurs, était peut-être un peu différent de ce qu’il est devenu par la suite, il y a des témoignages sur, effectivement, Malraux au ministère de la Culture, sur les rapports de Malraux avec les compagnons. Tout cela est extrêmement riche, mais est-ce que la nature des relations entre de Gaulle et Malraux n’allait pas beaucoup plus loin finalement que cela entre ces deux écrivains qui étaient deux grands solitaires ?
M.S. – Deux écrivains, deux écritures, avez-vous dit, et en même temps deux solitaires, c’est tout à fait vrai. Vous avez ajouté quelque chose qui me semble encore plus vrai, vous avez parlé de métaphysicien du refus, ce qui a un sens extrêmement précis : ce n’est pas une formule d’écrivain, ce n’est pas un fruit de votre écriture. Moi-même, d’ailleurs – nous ne nous étions pas concertés – dans l’exposé que j’ai fait en conclusion, citant Brincourt, j’ai expliqué pourquoi, avec ces deux hommes, la métaphysique n’avait pas fini de court-circuiter l’histoire. La vérité, quelle est-elle ? C’est qu’au départ ces deux hommes qu’on présente parfois, surtout l’un d’eux, comme des espèces de nationalistes attardés qui voient la France comme une réincarnation permanente de l’épopée napoléonienne ou de la grandeur louis-quatorzienne, étaient l’un obsédé par la fragilité de la France, l’autre (Malraux) par la fragilité du destin de l’homme. Cette obsession de la fragilité est ce qu’ils avaient en commun et, à peine avaient-ils pris conscience de cette fragilité, à peine s’étaient-ils convaincus que la France était mortelle, qu’elle était même menacée de disparaître de décennie en décennie ou de demi-siècle en demi-siècle, que venait le sursaut et ce sursaut, c’était l’anti-destin. J’ai dit en conclusion de mon exposé final : on dit que de Gaulle a été l’homme du destin et Dieu sait si c’est vrai, mais peut-être son amitié avec Malraux nous révèle-t-elle qu’il a été aussi et surtout l’homme de l’anti-destin.
P.S.R. – Alors, comment Malraux voyait-il, lui, le Général ? Parce que, si vous avez cité tout à l’heure ce que le Général a écrit sur Malraux – mais on sait que le Général était un homme réservé, qu’il ne s’est pas tellement exprimé sur ses relations personnelles avec les hommes (peut-être existe-t-il une correspondance entre le Général et André Malraux que nous connaîtrons mieux un jour)- nous savons davantage ce que Malraux a écrit sur le général de Gaulle soit dans les Antimémoires, première version, soit dans le fameux livre Les Chênes qu’on abat et j’ai toujours été frappé par cette très belle phrase où Malraux dit, parlant du général de Gaulle : « Son intelligence tient au niveau de sa réflexion plus qu’à sa réflexion elle-même ou à sa pénétration ». C’est une intelligence de vocation qu’a le général de Gaulle ?
M.S. – Il veut probablement dire c’est une intelligence inséparable de l’acte. Je pense beaucoup à cette phrase de Jules Lagneau, le maître d’Alain, sans laquelle le 18 juin est incompréhensible : « La certitude est une région profonde où la pensée ne se maintient que par l’action ». Vous avez remarqué que c’est un point tout à fait commun aux deux hommes, la pensée du général de Gaulle se traduit en action et le verbe, c’est-à-dire l’appel du 18 juin, n’est que le véhicule de l’action, il est un acte, la parole est un acte, le verbe est lui-même un acte. Il en va exactement de même de Malraux qui écrit pour agir, qui n’écrit pas pour substituer l’écriture à l’action mais qui écrit pour faire de l’écriture un acte. Ses chefs d’oeuvres sont des actes. La Condition humaine est un acte politique d’ores et déjà, L’Espoir est un acte politique par exemple. Et lorsque le général de Gaulle lui a apporté la possibilité de ne pas agir seulement par l’écriture mais d’agir dans l’action comme il a agi par l’écriture, naturellement, il saute sur l’occasion. Je crois d’ailleurs, je le dis très franchement, que pendant la seule période de ma vie publique où je n’ai pas été avec eux au sens physique du terme, c’est-à-dire à l’époque du RPF, il n’était pas à l’aise parce que là, le verbe même génial, n’embrayait sur l’action.
P.S.R. – Le verbe était en attente. Peut-on dire que finalement le général de Gaulle et André Malraux avaient, pour des raisons différentes, une appréhension égale du mal ? Quand, dans les Antimémoires, Malraux dit : « Le mal a reparu sur la terre », vous vous souvenez, ces phrases très fortes qu’il dit à Edmond Michelet ou qu’Edmond Michelet lui rapporte…
M.S. – Que ce soit vrai chez Malraux, c’est évident, que ce soit vrai chez de Gaulle, c’est beaucoup moins connu. C’est moins connu, mais je vais vous en apporter deux preuves : une preuve qui n’est pas sue de tout le monde. Geneviève de Gaulle revient de déportation et le Général l’interroge sur ses souffrances et, un un moment donné, il l’interrompt et il lui dit : « ça me rappelle les tranchées, la vie et la mort du fantassin, tout ce qui m’a laminé l’âme ». Bien évidemment, de Gaulle ne disait pas cela à n’importe qui. Quand il était colonel, il ne le disait pas à ses officiers et sous-officiers ou à ses hommes. Pendant la guerre, il ne le disait pas aux volontaires des Forces françaises libres. Il l’a dit à sa nièce, il l’a dit à quelqu’un qui était de sa chair et de son sang au moment où deux calvaires se sont, en quelque sorte, rejoints, voilà la première preuve. La deuxième preuve, c’est la réaction dont j’ai été d’abord le témoin et dont j’ai été ensuite, si j’ose dire, le lecteur après l’explosion de la bombe d’Hiroshima. Lisez les journaux du mois d’août 1945, y compris L’Humanité – et je vais m’exprimer dans un langage très académique et très distingué – ça se ramène à une phrase : « Bien fait pour leur pomme ! » Ah ! il y a eu Pearl Harbor, ah ! ils ont été des alliés des nazis et des fascistes, eh bien Hiroshima c’est la vengeance du ciel. On en parlait d’autant plus qu’on croyait moins au ciel. Cela A été une réaction quasi unanime. Le général de Gaulle, lui, j’en ai été le témoin, je l’entends encore, a été profondément bouleversé par la révélation de cette puissance de destruction de l’homme par l’homme qui pouvait conduire à la disparition de l’humanité. Il a été le premier et le seul. Voilà deux preuves de cet état d’âme, au sens le plus profond et le plus propre du terme, dont vous avez été vous aussi témoin.
P.S.R. – Est-ce qu’ils avaient en commun une part d’irrationnel ?
M.S. – Ah certes, Dieu merci, celle du poète. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette comparaison que Malraux a faite un jour entre lui-même et le chat de Mallarmé ?
P.S.R. – Oui, en effet… quand il joue à être le chat de Mallarmé…
M.S. – Il dit quelque part : « Et je suis un peu à côté de De Gaulle comme le chat qui disait : je suis le chat de Mallarmé ».
P.S.R. – Je me souviens. Mais il y a une phrase qui m’intrigue tout de même dans Les Chênes qu’on abat, c’est lorsque Malraux dit, parlant du général de Gaulle : « Il pense qu’à ma manière j’ai la foi et moi je pense qu’à sa manière il ne l’a pas ».
M.S. – Ils avaient raison tous les deux. Pourquoi ? Parce que la foi du général de Gaulle ne l’a jamais délivré d’une certaine angoisse de la mort, d’une certaine haine de la mort. C’est un point très important. Il n’en a jamais eu le moins du monde peur, il l’a vaincue comme tous les hommes d’action et de pensée, mais il la détestait ; il ne craignait pas sa mort, il craignait la Mort avec un grand M. Que de fois, dans les entretiens que nous avons eus avec lui, nous l’avons entendu citer Bismarck : « Oh ! de toute manière, en définitive, c’est la mort qui gagne ». C’est ce que voulait dire très probablement Malraux quand il disait qu’à sa manière, il n’avait pas la foi. Et quant à l’angoisse métaphysique de Malraux au bord du mystère, pensons à l’abbé Bockel et à son témoignage. Vous vous rappelez le témoignage de l’abbé Bockel. Je crois que j’ai eu l’occasion de le citer dans un autre ouvrage : Malraux être et dire, qui a été publié il y a un certain nombre d’années. L’abbé Bockel souligne que Malraux lui a dit un jour : « Rien de tout cela n’a de sens si Dieu n’existe pas ». Je ne cite probablement pas textuellement, mais je suis sûr de ne pas trahir ses intentions.
P.S.R. – Cela rejoint la phrase célèbre de Dostoïevski. Vous souvenez-vous aussi de cette phrase qui m’avait beaucoup frappé, prononcée à Rome, le 31 mai 1967, c’est-à-dire très peu de jours avant la guerre des Six jours, par le général de Gaulle, lorsqu’il a dit, devant la communauté ecclésiastique française de Rome : « Quels que soient les dangers, les crises, les drames que nous devons traverser, toujours nous savons où nous allons ; même s’il nous faut mourir, nous allons vers la vie ». Vous vous souvenez de cette phrase ?
M.S. – Alors là, c’est l’autre aspect de ce que disait …
P.S.R. – C’est une contribution, si je puis dire, au thème de la métamorphose chez Malraux.
M.S. – C’est exactement cela. C’est une contribution à ce thème de la métamorphose qui a pris à la fin de la vie de Malraux une forme très curieuse quand il a vu dans la biologie moléculaire le mythe du destin de l’homme. Le rôle que l’histoire avait traditionnellement joué, c’était la biologie moléculaire qui allait le jouer à son tour. Il était passionné par cette nouvelle forme de la science et ce n’est pas par hasard car la grande révélation de la biologie moléculaire , c’est qu’il n’y a pas deux hommes identiques : c’est donc la consécration de l’individualité par la science, l’individualité en tant que fin en soi, et ce dernier avatar de l’esprit métaphysique de Malraux est très significatif.
P.S.R. – Dans les débats qui ont entouré le colloque, il y a eu une petite confrontation sur le point de savoir si André Malraux avait été ou non un militant de ce qu’il était convenu, à l’époque, d’appeler le gaullisme de gauche, c’est-à-dire, notamment, de la participation. Certains disaient que, en fin de compte, du temps du RPF, Malraux ne s’intéressait pas tellement à cet aspect du gaullisme. Mon souvenir était, en revanche, qu’au temps de Notre République il s’était assez engagé au côté de René Capitant et de Louis Vallon, et d’autres dont j’étais à l’époque. Quel est votre souvenir ?
M.S. – Là, vous m’emmenez, Philippe, à produire un témoignage dont je crois bien que je n’ai jamais fait état : il est faux, et sur ce point, j’inflige un démenti posthume à André Malraux, il est faux que le Général ait lancé son dernier référendum dans le souci de le perdre et pour descendre du pouvoir…
P.S.R. – C’est ce que croyait André Malraux ?
M.S. – C’est ce que Malraux a dit tout au moins : il a achevé sa tâche de statuaire en lui donnant une touche suprême qui convenait bien au Général mais qui ne correspond pas à la vérité. Ce qui est vrai, c’est que le Général, en cours de campagne, s’est rendu compte qu’il allait perdre et, au début de la campagne, il m’avait donné comme instruction – j’ai été son dernier ministre des Affaires sociales – de tenir tout prêt un texte de loi allant beaucoup plus loin que ce qui a été accompli depuis lors, et même de ce qui est en voie d’accomplissement aujourd’hui, dans le sens de la participation. Ce texte, d’ailleurs, je l’ai publié depuis lors, mais peu importe : ce qui importe, c’est l’instruction qui m’avait été donnée. Je l’ai donc établi et, le jeudi qui a précédé le référendum, dans la conversation que j’ai eue avec lui, il m’a dit : « – Nous allons perdre, c’est dommage car le véritable enjeu c’était vous. – Moi, mon Général ? – Pas vous, Maurice Schumann, bien entendu, mais vous, ministre des Affaires sociales. Si les Français n’avaient besoin que d’être rassurés au lendemain des événements de 68, ils n’avaient plus besoin de De Gaulle, ils en trouveront bien un autre, si en revanche, ils voulaient tirer la conclusion de cet événement, qui est un événement sans lendemain mais qui n’est pas un événement sans avenir, alors nous pouvions rendre un suprême service. – Mon Général, si nous gagnons, le texte est prêt, nous le déposerons sur le bureau de l’Assemblée la semaine prochaine. – Nous ne gagnerons pas, mais gardez-le, il pourra toujours servir ». Or, dans l’intervalle, j’avais présenté ce texte en le commentant au conseil des ministres. Je ne suis pas absolument sûr qu’il ait été du goût de tous mes collègues de l’époque. J’en doute. Ce que je sais, c’est que Malraux a pris la parole pour l’appuyer et pour dire que l’on devrait souligner au cours de la campagne que là était le vrai sens du référendum, qu’il ne s’agissait pas d’une réforme du Sénat, qu’il ne s’agissait pas même d’un début de décentralisation, qu’il s’agissait d’un choix de principe pour la Réforme avec un grand R, au lendemain des événements de 68 dont il fallait tirer la leçon.
P.S.R. – Peut-on dire qu’il s’agissait de tout autre chose en fait, dans cette affaire, que d’une question de niveau de vie et que la justice sociale devenait plutôt, dans cette optique, une préoccupation d’ordre spirituel destinée un peu à donner à la France, à l’intérieur du monde auquel elle appartient vaille que vaille, une originalité, une particularité ?
M.S. – Je m’éloigne un peu de vous. Il y avait cela aussi. Il y avait le message spécifique que la France doit donner au monde, qui est aussi éloigné que possible du message marxiste et qui ne ressemble pas non plus au message libéral à la mode du XIXe siècle.
P.S.R. – … auquel on revient un petit peu…
M.S. – S’il s’agit d’un néo-libéralisme, qui a peut-être le tort de porter ce nom mais qui est très différent, même à l’heure actuelle, du « laissez faire, laissez passer » de Frédéric Le Play ou plus exactement de Frédéric Bastiat. Il y avait cela, mais je m’éloigne là un peu de vous. La précision et la vigilance avec lesquelles, en me faisant confiance, le général de Gaulle s’intéressait au travail de son ministre des Affaires sociales, démontrent qu’il ne croyait pas que l’intendance suit, et qu’il était, à cet égard, dans le concret ou qu’il faisait confiance aux ministres qu’il avait choisis – à moi comme à d’autres – pour donner une traduction concrète à ce qui était nécessairement un grand rêve à partir du moment où il se l’était approprié. Car tout ce qu’il s’appropriait devenait grand rêve par son verbe, et c’est encore un point commun avec Malraux.
P.S.R. – Maurice Schumann, est-ce que Malraux a eu raison de dire à la fin qu’il ne pourrait pas y avoir de gaullisme sans de Gaulle ? Est-ce qu’en disant cela, il ne réduisait pas un peu le général de Gaulle à une aventure ? Et est-ce qu’il ne lui retirait pas ce qu’il a de toute manière d’appartenance à la France profonde ou à l’histoire de la France ?
M.S. – Je crois que ce que voulait dire Malraux, et vous touchez là un point très sensible pour moi, ce que voulait dire Malraux, c’était : » Ma présence au gouvernement n’a aucun sens à partir du moment où il est parti ».
P.S.R. – Et ça ne veut dire que cela, alors…
M.S. – Et là il avait parfaitement raison, mais attention : je suis devenu ministre des Affaires étrangères au lendemain de son départ. par l’intermédiaire de Michel Debré et d’un de ses collaborateurs, je m’étais assuré de son approbation, approbation d’ailleurs tacite mais approbation explicite à l’égard des deux principaux intéressés, c’est-à-dire de Michel Debré qui restait dans le gouvernement, et de moi-même qui lui succédais. Mais je dois à la vérité de dire que la phrase se terminait par ses mots : « De toute façon, la page est tournée ». Et c’est pourquoi, dans le premier discours que j’ai prononcé comme ministre des Affaires étrangères, j’ai dit : « La page est nécessairement tournée, mais puissent les autres être écrites sur le même livre ». Et je crois que c’est la réponse à votre question.
P.S.R. – Peut-on dire que l’éthique d’André Malraux se fondait beaucoup sur la fraternité alors que peut-être le général de Gaulle demeurait attaché à la vieille charité qui nous a été apprise ? Cela se rapprochait beaucoup, mais il y avait une nuance.
M.S. – C’est vrai, vous pensez au Klein des Conquérants par exemple. Mais ne croyez pas qu’ils étaient étrangers à ce sentiment. L’avez-vous jamais vu avec des anciens combattants de la Première Guerre mondiale ?
P.S.R. – Peut-être pas.
M.S. – Alors je vais vous raconter, moi je l’ai vu, et franchement, quand il disait : « Ah ! voilà les anciens… »
P.S.R. – Là, vous parlez du général de Gaulle ?
M.S. – Oui. Cela venait de très loin, de ses entrailles. Je vais vous raconter une anecdote que j’ai vécue à Lille. Le Général vient comme président de la République, il passe devant une vieille dame. Cette vieille dame était la présidente des veuves de guerre, on lui donne son nom, et le Général lui dit : « Est-ce que votre mari n’a pas été tué à tel endroit, à côté de Douaumont, et tel jour ? – Mais si, Général. – Son prénom était bien X ? Que sont devenus votre fils [je cite n’importe quels prénoms] Philippe et votre fille Lucienne ? » Et le fils dont le prénom n’était pas Philippe, mais dont le prénom était bien celui qu’avait indiqué le Général, et qui était derrière sa mère, a été pris d’une espèce de tremblement de stupeur… Je vous rappelle que nous sommes cinquante ans après l’événement. Et le soir, en dînant, je dis au Général : « Mon Général, je n’ai pas l’habitude de vous dire les raisons pour lesquelles je vous admire, mais là, je vous avoue que je n’en suis pas encore revenu ». Il m’a regardé et il m’a dit : « ça prouve que vous n’avez pas fait la guerre de 14 [en effet, je suis né en 1911), car si vous aviez fait la guerre de 14, vous sauriez les liens qui se nouaient la veille d’une attaque entre ceux, capitaines et adjudants, capitaines et simples soldats, qui allaient quelques heures plus tard mourir ensemble ». Vous ne trouvez pas que cela ressemble à du Malraux ?
P.S.R. – Tout à fait. Vous souvenez-vous, Maurice Schumann, de ce qu’avait déclaré le général de Gaulle à Alger, c’était le 3 octobre 1943, devant les membres de l’Alliance française : « Lorsqu’un jour l’historien, loin des tumultes où nous sommes plongés, constatera les tragiques événements qui faillirent faire rouler la France dans l’abîme d’où on ne revient pas…
M.S. – Je vous vois venir.
P.S.R. – … il constatera que la Résistance, c’est-à-dire l’espérance nationale, s’est accrochée sur la pente à deux pôles qui ne cédèrent point, l’un était le tronçon de l’épée, l’autre la pensée française ». Eh bien, c’est Malraux…
M.S. – C’est Malraux, et j’irai plus loin : c’est l’espoir, parce que le 18 juin 1940, ce n’est pas seulement le sursaut d’honneur de l’homme qui dit : « Même si tout est perdu, coulons avec le bateau », c’est aussi le raisonnement de l’homme qui dit : il faut que la France soit un vainqueur à part entière, donc qu’elle ne déserte pas une minute le camp de la victoire. Une des phrases favorites du Général avant sa rencontre avec Malraux, c’était : « L’espoir est toujours vainqueur ».
P.S.R. – Maurice Schumann, je vous remercie. Je rappelle que nous avons parlé du général de Gaulle et d’André Malraux autour de la publication par la librairie Plon et sous l’égide de l’Institut Charles-de-Gaulle des actes du colloque tenu par cet Institut, il y a un an, sur les rapports de De Gaulle et Malraux. Je signale « également qu’il existe un autre ouvrage consacré à André Malraux et le gaullisme, qui est dû à une universitaire, Madame Jeannine Mossuz-Lavau, et qui a été publié en 1982 aux Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques. C’est un très bon livre de référence.
*Ce colloque a été organisé par l’Institut Charles de Gaulle les 13,14 et 15 novembre 1986
C’était De Gaulle
Le 9 janvier 1963 dans c’était de Gaulle d’alain Peyrefitte
« Les Américains font croire que ne pas être d’accord avec eux, si vouloir rompre l’alliance atlantique et mettre en danger la liberté de l’Occident. Cuba leur est montée à la cervelle. En Amérique du Sud, en Europe, en Asie, tout le monde en colonne par deux derrière l’Oncle Sam, sinon gare à vous ! (Rire.) Ce serait contraire à la solidarité et à la morale ! Voyons, Peyrefitte, c’est de la rigolade !
« Les Américains racontent que je voudrais obtenir des concessions, que je suis sur le chemin de la négociation, c’est-à-dire de la capitulation : eh bien, non ! Je ne demande rien, je ne souhaite rien, si ce n’est boire dans mon verre et coucher dans mon lit. […]
« En matière atomique, les Anglais n’ont rien fait qu’avec et par les Américains. Nous avons tout fait sans personne et par nous-mêmes. Les Américains croyaient :
« 1) que nos scientifiques ne seraient pas capables ;
« 2) que nous n’aurions pas les moyens financiers ;
« 3) que de Gaulle allait être contraint de quitter le pouvoir dès qu’ils fronceraient les sourcils.
Évidemment, Guy Mollet ou Félix Gaillard se seraient contentés de quelques paillettes d’intégration ou de communauté atlantique.
« Le grand problème, maintenant que l’affaire d’Algérie est réglée, c’est l’impérialisme américain. Le problème est en nous, parmi nos couches dirigeantes, parmi celles des pays voisins. Il est dans les têtes !